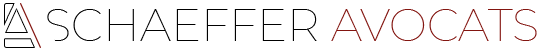La protection des mineurs étrangers en France s’inscrit dans un cadre juridique à la croisée du droit interne, du droit européen et du droit international des droits de l’homme. Conformément à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, « l’intérêt supérieur de l’enfant » doit primer dans toutes les décisions qui le concernent. Ce principe irrigue aujourd’hui les dispositifs français relatifs à l’accueil, la scolarisation, l’hébergement et la régularisation des mineurs étrangers, qu’ils soient accompagnés ou isolés.
Ainsi, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de l’éducation et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent une série de droits fondamentaux reconnus à ces jeunes, notamment le droit à l’instruction, à la protection contre toute forme de maltraitance, et à un hébergement adapté.
Toutefois, la mise en œuvre effective de ces droits demeure complexe : disparités territoriales dans la prise en charge, lenteurs administratives, contestations de minorité et difficultés d’accès au séjour à la majorité fragilisent la cohérence du système. Ces tensions ont conduit à une abondante jurisprudence et à de multiples interventions du Défenseur des droits, soulignant la nécessité d’une approche plus harmonisée et protectrice.
Sommaire :
En France, le droit à l’éducation est universel et s’applique à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative.
Obligation scolaire : L’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de 3 à 16 ans, conformément à l’article L.131-1 du Code de l’éducation, sans distinction de nationalité ni de statut administratif.
Égalité des droits : Les élèves étrangers bénéficient des mêmes droits et devoirs que les élèves français. Le principe d’égalité devant le service public de l’éducation s’impose à toutes les autorités locales.
Procédure d’inscription : L’inscription à l’école publique se fait généralement à la mairie du lieu de résidence. L’enfant doit être présent sur le territoire français ; aucun titre de séjour n’est requis.
Accompagnement des élèves allophones : Des dispositifs spécifiques, tels que les UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants), facilitent l’apprentissage du français et l’intégration scolaire.
Ainsi, le droit à l’éducation constitue une pierre angulaire de la protection des mineurs étrangers en France.
1- Prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)Lorsqu’un jeune se déclare mineur et privé de la protection de sa famille, il relève de la compétence du président du conseil départemental, au titre de la protection de l’enfance. Conformément aux articles L.223-2 et R.221-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le département doit organiser un accueil provisoire d’urgence, également appelé mise à l’abri, d’une durée initiale de cinq jours, renouvelable deux fois pour la même durée, sous le contrôle du procureur de la République.
Cette période vise à assurer la sécurité immédiate du jeune et à permettre une évaluation pluridisciplinaire de sa situation, menée par des professionnels qualifiés conformément à l’arrêté du 17 novembre 2016. L’évaluation doit apprécier notamment la minorité, l’isolement familial et les besoins de protection.
Au terme de cette évaluation, un rapport motivé est transmis au président du conseil départemental, qui décide de la poursuite ou non de la prise en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance.
Les jeunes majeurs étrangers doivent déposer une demande de titre de séjour en préfecture avant leur dix-neuvième anniversaire. Cette démarche est cruciale pour éviter toute rupture de droits après la majorité.
Les conditions diffèrent selon l’origine :
Les jeunes majeurs confiés à l’ASE continuent de bénéficier d’un contrat jeune majeur, permettant un hébergement et un accompagnement éducatif jusqu’à 21 ans, même en l’absence de titre de séjour régulier.
Toutefois, pour travailler, suivre une formation professionnelle ou percevoir certaines aides, le titre de séjour reste indispensable.
En France, la majorité civile est fixée à 18 ans. À cet âge, le jeune étranger devient pleinement responsable de ses actes et peut :
Les mineurs nés ou ayant grandi en France peuvent, dans certains cas, acquérir la nationalité française à leur majorité, s’ils ont résidé habituellement en France pendant au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans (article 21-7 du Code civil).
L’intégration sociale et professionnelle constitue un levier essentiel de régularisation et d’autonomie.
Les parcours demeurent inégaux selon le sexe, la langue ou le niveau de scolarisation antérieur, ce qui nécessite une attention accrue des pouvoirs publics.
La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont consolidé la protection juridique des mineurs étrangers.
Dans sa décision du 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision administrative ou judiciaire.
Les examens osseux, par exemple, ne peuvent être pratiqués qu’avec le consentement éclairé du mineur et ne peuvent constituer le seul élément d’appréciation de l’âge.
Le Défenseur des droits reçoit chaque année des réclamations relatives aux conditions d’accueil et de régularisation des mineurs non accompagnés.
Il intervient pour garantir :
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France à plusieurs reprises pour manquements à ses obligations de protection.
Dans l’affaire A.C. c. France, la Cour a jugé que le requérant, un jeune guinéen, n’avait pas bénéficié de garanties suffisantes lors de l’évaluation de sa minorité, entraînant une violation de ses droits fondamentaux au regard de l’article 8 de la Convention européenne.
Les associations de défense des droits humains, les barreaux et les organisations professionnelles d’avocats jouent un rôle déterminant dans la défense des mineurs étrangers :
Ces acteurs contribuent à la promotion d’une culture des droits fondamentaux et à l’évolution des pratiques judiciaires.
La France dispose d’un arsenal juridique robuste pour garantir les droits des mineurs étrangers et des jeunes majeurs. Cependant, les écarts entre le droit et la pratique demeurent préoccupants : délais d’évaluation excessifs, disparités entre départements, obstacles administratifs ou rupture de prise en charge à la majorité.
Renforcer la coordination entre services publics, magistrats, associations et avocats est essentiel pour rendre ces droits effectifs et pour que chaque jeune, quel que soit son parcours, puisse bénéficier d’une protection conforme aux valeurs républicaines et aux conventions internationales ratifiées par la France.
Un MNA est un jeune de moins de 18 ans arrivé en France sans représentant légal, nécessitant une prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Non, un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Toutefois, à sa majorité, il peut être concerné par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) s’il n’a pas régularisé sa situation.
Tous les enfants présents sur le territoire français ont droit à l’instruction, indépendamment de leur statut administratif.
Avant ses 19 ans, le jeune doit déposer une demande de titre de séjour en préfecture, notamment s’il a été confié à l’ASE avant sa majorité.
Les MNA bénéficient d’une mise à l’abri, d’un hébergement et d’un accompagnement éducatif et juridique par l’ASE, sous le contrôle du juge des enfants.
Plus de 20 ans d’expérience pour mieux vous assister. Nos avocats peuvent intervenir partout en France pour vous offrir un service de haute qualité sur tout le territoire.
Site immobilier:
Schaeffer-avocats-immobilier.com
Site juridique:
Lawperationnel.com
Cabinets principaux:
10 rue louis vicat - 75015 Paris
18 grande rue - 91260 JUIVISY
Nos bureaux:
Bobigny
Montpellier
Bourg-la-Reine
Créteil
Nanterre
Meaux
Melun
Évry